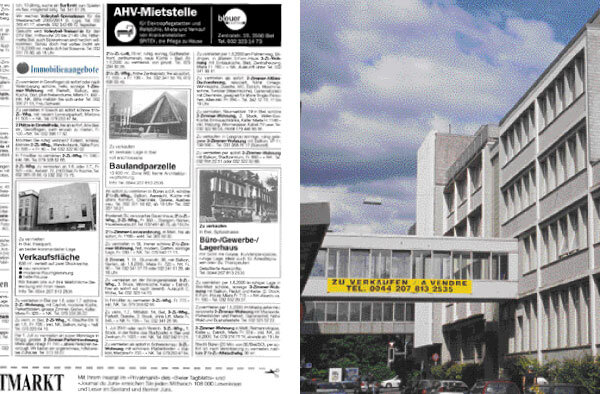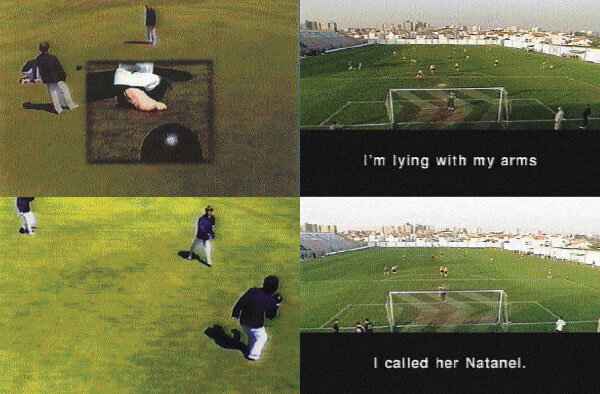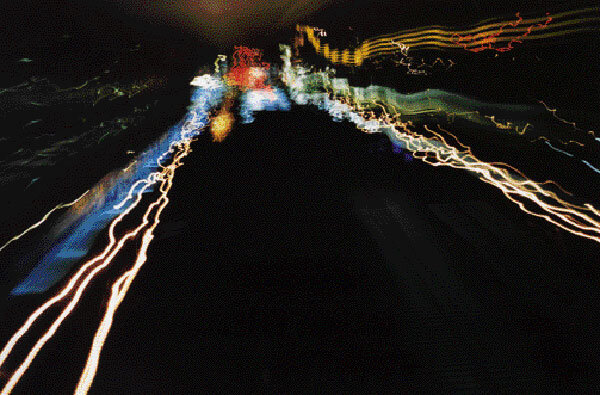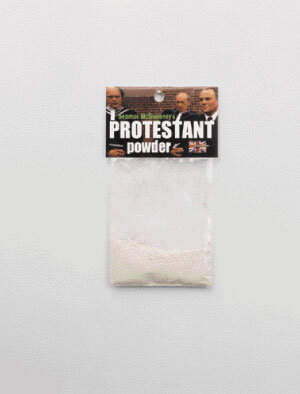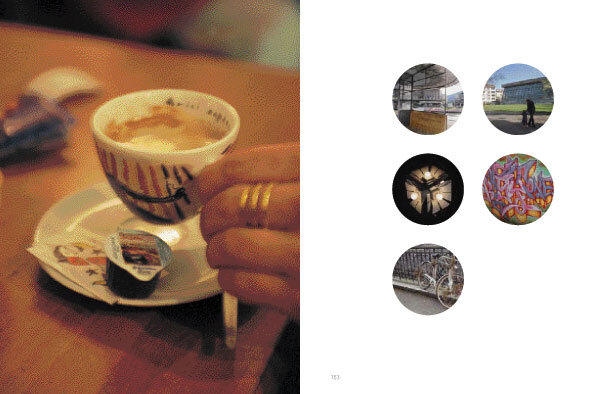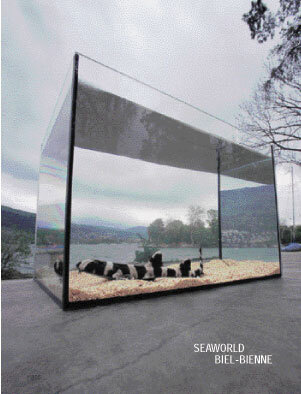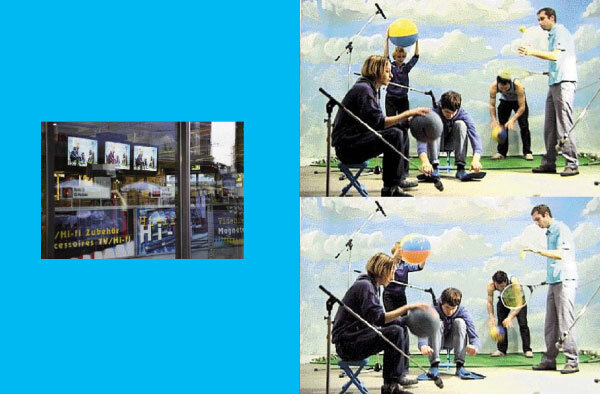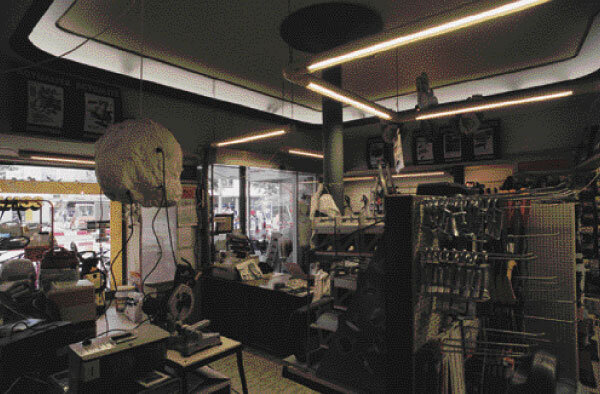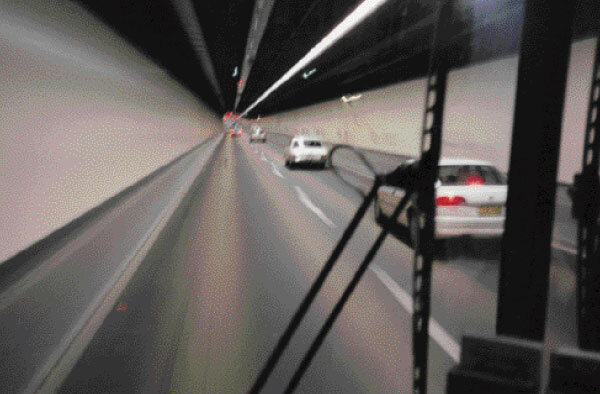TRANSFERT Art dans l’espace urbain
Joshua Decter
JOSHUA DECTER
COMMUNICATION-VILLE
Métaphoriquement, toute personne est une ville, tout comme chaque ville est fondamentalement un composé – une incarnation abstraite et matérielle – de sa population par rapport à des codes et systèmes spécifiques d’habitation. Les territoires urbains autour du globe diffèrent tous de façon évidente (comme vous le rappellera n’importe quel touriste), tout comme il existe des différences entre les pays en voie de développement et les nations capitalistes avancées. Par conséquent, proposer une définition universalisante et unique de ce que serait une ville, reste une position intenable. Toute ville, quelles que soient sa position sur le globe et/ou sa situation sociopolitique, est un complexe multidimensionnel d’éléments à chaque fois paradoxaux, où hétérogénéité et homogénéité coexistent dans un état de tension constante. Les villes ont la capacité de tout incorporer dans leur texture dense : elles sont à la fois des éponges d’échanges sociaux, et des déclencheurs de toutes les formes possibles de transformation. Tous les contextes urbains se caractérisent par des entrelacs de rythmes, de stase et de mouvement. La ville est un amalgame d’espace public, d’espace privé, de social et d’antisocial, de politique, de religion, de culture, de santé, de maladie, de richesse, de pauvreté, de loi, de criminalité, de sexualité, d’abstinence, de naissance, de mort, de saleté, d’électricité, de systèmes de communication, de faune, de flore, de systèmes de transport (aussi bien publics que privés), d’architectures diverses et de bien d’autres choses encore.
Le philosophe Henri Lefebvre conçoit la ville comme une arène destinée à la “rencontre des différences”, comme un espace qui à la fois produit des relations sociales et est produit par des relations sociales. Lefebvre suggère que nous avons tendance à penser le milieu urbain contemporain de manière dichotomique : il serait tout à la fois un espace abstrait basé sur des ordonnancements hiérarchiques (par exemple centre et périphérie) qui peuvent renforcer les relations économiques dominantes, et un espace de ruptures, de disjonctions et de “pulvérisations” (c’est le terme qu’utilise Lefebvre). Allant à l’encontre de la volonté d’homogénéisation de l’espace urbain (et partant de l’expérience urbaine), volonté qui est conforme à la logique du capitalisme avancé, les sujets sociaux – c’est-à-dire les individus – tentent d’articuler des applications distinctes de cet espace, d’utiliser l’imagination comme un dispositif permettant de réinventer leurs négociations vis-à-vis de l’ordre urbain.
“Les éléments mobiles d’une ville, et en particulier les gens et leurs activités, ont autant d’importance que les parties physiques stables. Nous ne sommes pas de simples observateurs de ce spectacle, mais nous en faisons nous-mêmes partie, nous sommes sur scène avec les autres participants. Le plus souvent notre perception de la ville n’est pas soutenue, mais bien partielle, fragmentaire, mêlée à d’autres préoccupations. Presque tous les sens sont impliqués, et l’image en est le composé.”1
Dans une certaine mesure, le développement du genre d’exposition d’art dans l’espace urbain au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle est lié à une problématique plus vaste. Il s’agit d’un effort visant à ouvrir l’autonomie relative de l’art d’avant-garde, à redistribuer la pratique, le langage et les idéologies de l’art pour les faire entrer dans le tissu de la soi-disant “vie quotidienne”. On entend faire sortir l’art des emballages spécialisés à son usage (c’est-à-dire l’atelier, la galerie, le musée, la collection privée) et l’intégrer dans les zones soi-disant ordinaires de la vie : par exemple la rue, la maison, etc. Autrement dit, cela revient à restituer l’art aux domaines non-spécialisés, tout en créant la possibilité de réinventer des rapports entre culture et public. En un sens, ceci reflète une préoccupation récente (c’est-à-dire de la fin du 20ème siècle) visant à réinjecter l’activité isolée du monde artistique des premières avant-gardes dans les tendances générales de l’activité culturelle.
Après l’émergence des centres urbains industrialisés en Europe au milieu et à la fin du 19ème siècle, accompagnée auprès de la bourgeoisie par la conscience d’appartenir à un nouveau modèle d’organisation sociale (celui-ci ayant été reproduit non sans un retentissement frappant et poétique dans les écrits de Baudelaire, puis dans les flâneries métaphoriques de Breton à travers Paris, et plus tard encore dans les écrits situationnistes de Guy Debord), le terrain était préparé à une conception de la ville en tant que contexte prêt à recevoir le déploiement de l’expérience esthétique, et qui deviendra un trope décisif – sinon paradigmatique – du 20ème siècle. C’est la ville qui, en tant que muse, en un sens a remplacé la nature dans cette fonction. Artistes, poètes, architectes et autres producteurs culturels manifestaient un nouveau sublime urbain quand ils utilisaient l’énergie sociale de la ville à des fins d’expérimentation et d’innovation.
Comment sans cela comprendre les premiers collages de Picasso. Il incorporait des fragments de journaux dans la texture sémiologique et matérielle de son langage artistique, dénotant ainsi un système premier, “quotidien”, de communication de masse à l’intérieur du cadre urbain. Ou encore, rappelez-vous les invocations d’une expérience moderne nouvelle telles que dans certaines œuvres de futuristes italiens qui, non seulement s’émerveillaient devant la toute jeune dynamique de l’industrialisation moderne, mais, chose plus significative encore, s’efforçaient d’invoquer visuellement la simultanéité de l’espace social urbain inauguré au cours des premières décennies du 20ème siècle. Et n’oublions pas les visions des relations entre travail, construction et industrialisation de Fernand Léger. Et aussi, et c’est peut-être le plus important, souvenons-nous des activités des dadaïstes qui prenaient souvent en compte de manière stratégique l’utilisation de l’espace urbain en tant que point de départ à des révoltes matérielles et symboliques contre l’homogénéité apparente de la vie et des valeurs bourgeoises – et l’aliénation corrélative de l’art d’avant-garde vis-à-vis d’un contexte socioculturel plus large. Cependant, si l’on se réfère à cette histoire, il faut sans nul doute prendre en compte un paradoxe culturel récurrent. Par exemple, pour ce qui est des implications du dadaïsme, nous devrions reconnaître que toute tentative anarchique de faire sauter, de subvertir les conventions artistiques était en même temps, peut-être inconsciemment, un effort d’intégrer l’art dans son contexte social et politique – c’est-à-dire de lui restituer une fonction instrumentale (mais sous l’apparence du non-instrumental). C’est là peut-être une négation de l’art en vue d’inventer un autre ensemble de relations culturelles.
Dans un texte controversé et largement discuté datant de septembre 1980, “Die Moderne – ein unvollendetes Projekt”, Jürgen Habermas apporte sa réflexion sur un autre aspect du paradoxe. En effet, Habermas suggère que la révolte surréaliste contre la rationalisation (qui plonge ses racines dans la période qui suit les Lumières) et contre la division entre l’art et la vie (c’est-à-dire contre la réconciliation conceptuelle et symbolique entre objet d’art et objet utilitaire, entre jugements esthétiques et connaissance quotidienne) a entraîné, ironiquement, le renforcement de l’autonomie du domaine esthétique. Le philosophe affirme que même les attaques les plus radicales contre l’autonomie bourgeoise de l’art (de la part d’artistes et d’autres spécialistes des arts) n’ont servi qu’à fragmenter momentanément divers contenus du domaine culturel autonome (c’est-à-dire du domaine de la culture des arts plastiques). L’autonomie de l’art en sortait donc renforcée, puisque les assauts contre un domaine culturel spécifique (l’art d’avant-garde) ne pouvaient conduire à la transformation – c’est-à-dire la dé-sublimation – d’une société rationalisée dans laquelle il n’y avait aucune communication envisageable entre des champs de spécialisation distincts. Si l’on accepte l’argumentation d’Habermas, il devient peut-être possible de comprendre comment le domaine relativement spécialisé et autonome du monde artistique récupère sans cesse les gestes sociaux, politiques, conceptuels ou esthétiques, même les plus radicaux, et les réduit au statut de conventions ou de genres.
Nous avons été les témoins du processus quasiment inévitable par lequel les divers langages artistiques “radicaux”, y compris les modes d’exposition novateurs et les stratégies audacieuses des commissaires, ont été récupérés en tant que – ou au sein de – conventions ou genres bien connus. C’est là peut-être la conséquence logique des caractéristiques historiques et idéologiques de l’avant-gardisme, où le “nouveau” se voit immanquablement institutionnalisé et réifié. Nous nous sommes habitués à l’oscillation continue entre expansion et contraction, entre progrès et régression. Bref : un pas en avant, deux pas en arrière. Chaque fois que nous essayons d’élargir le langage et/ou le contexte des pratiques artistiques jusqu’à un point de non-retour (c’est-à-dire jusqu’à l’effondrement de l’art et du “réel”), nous sommes reconduits à cette vérité inéluctable : l’art n’équivaut pas à la réalité “quotidienne”. L’art ne constitue-t-il pas sa propre réalité ? Et chaque fois que nous tentons de réinjecter ou de diffuser l’autonomie relative de l’art dans le territoire du quotidien, nous devons faire face au factum d’une incompatibilité fondamentale (au niveau du sens). Ceci a pour effet d’amplifier la distinction entre l’art et tout le reste, même si nous n’acceptons pas la prémisse selon laquelle l’art ne serait qu’une partie de quelque chose d’autre, de quelque chose qui ne serait pas de l’art. Au cours de ces cinquante dernières années (sinon davantage), cette espèce de dilemme philosophique – le dilemme fondamental de l’avant-garde – a causé beaucoup de frustrations auprès de certains artistes, théoriciens et commissaires qui y ont alors répondu en cherchant des territoires inédits à la création artistique. Fluxus, dans ses variantes américaines et européennes, reflétait cet esprit dans lequel on produisait un art qui devait résister à l’institutionnalisation historique grâce à ses caractéristiques éphémères, centrées sur l’événement. Pour une raison paradoxale évidente, Fluxus n’existe aujourd’hui que sous forme d’archive, puisqu’il dépend des systèmes traditionnels des musées et de l’histoire de l’art. Des traces de l’esprit post-Fluxus peuvent être détectées dans l’œuvre d’artistes d’une génération plus jeune. Ceux-ci émergent dans les années 1990, et ont re-considéré le modèle de l’activité artistique en tant qu’activité ou événement sociaux. Dans une certaine mesure, ceci a amené certains d’entre eux à revisiter des éléments de l’espace urbain considérés comme périphériques par rapport aux circonscriptions institutionnelles du monde de l’art. Un problème, du moins au niveau théorique, surgit dès qu’une activité artistique se déploie dans un contexte urbain non-traditionnel, ce contexte devant momentanément être redéfini comme une extension du système de l’art. C’est là un phénomène compliqué, intéressant, et inquiétant.
Vers la fin des années 1960 et le début des années 1970, bon nombre d’artistes conceptuels “post-atelier”, se sont intéressé au problème posé par l’expansion du langage et des sites de l’activité artistique. On songe par exemple à Douglas Huebler, Dennis Oppenheim, Lawrence Weiner, Daniel Buren, Robert Smithson, Michael Heizer et Alice Aycock, mais aussi aux interventions influentes, sur base urbaine, de Gordon Matta-Clark. Quant à Smithson, il importe de rappeler que sa pratique a toujours tenu compte du jeu subtil entre Site et Nonsite, entre un emplacement éloigné dans la nature, d’une part, et le contexte de la galerie d’art, d’autre part. Cet artiste a montré qu’il existait non pas un territoire “extérieur” au-delà du système de l’art, mais bien plutôt une série de relations dialogiques pouvant s’articuler ensemble dans des contextes distincts. Un peu plus tard, des artistes tels que Michael Asher et Hans Haacke retournaient vers le site de l’autorité culturelle – le musée – pour y opérer des infiltrations critiques et déconstruire le pouvoir institutionnel. De telles stratégies sont devenues à terme un genre de “critique institutionnelle”, reprise par Louise Lawler, Mark Dion, Christian Phillip-Muller et Andrea Fraser, pour ne nommer qu’eux. Par une ironie qui n’en est peut-être pas une, la critique institutionnelle s’est elle-même institutionnalisée ; c’est inévitable, puisque les tactiques d’infiltration exigent toujours un certain niveau de complicité avec les institutions muséales. Ces paradoxes et impasses (double bind) ont précipité ce que l’on pourrait appeler un effondrement tautologique, entraînant à sa suite la nécessité d’opérer à l’extérieur du système.
Mais où donc se trouve ce supposé “extérieur” ? Dans l’espace différencié/indifférencié de la ville ? Probablement, probablement pas. Mais le désir (ou le fantasme) se perpétue de localiser un espace de production culturelle qui ne soit pas embarrassé ou grevé par le système de l’art : le désir lui-même est paradoxal. Aujourd’hui, au moment où le système de l’art se mondialise, et qu’il se constitue en centres urbains reliés ensemble, ce désir s’exprime souvent en rapport à l’espace de la ville. En un sens, on pourrait parler de recolonisation de l’espace public urbain, celui-ci devenant la plate-forme où s’exprimeraient des activités artistiques spécialisées, et offrant aux artistes la chance de réagir directement à tous les aspects de l’environnement urbain quotidien. La ville comme laboratoire culturel ? La ville comme ready-made adapté ?
Dès le début des années 1970 aux États-Unis, divers genres d’art public et d’art in situ sont apparus, oscillant entre des formes de pratiques d’opposition très politiques, de base, et des variétés beaucoup plus bonasses de commandes d’entreprises, sans compter toutes les possibilités intermédiaires. Bien vite, des fondations privées et des organisations culturelles (ainsi que des services officiels, de niveau national ou local) sont alors mises sur pied, et offrent des structures favorables aux commandes faites aux artistes qui cherchaient à produire des œuvres outrepassant les limites de l’atelier, de la galerie et du musée. À New York par exemple, de petites organisations telles que Creative Time et The Public Art Fund ont la double fonction de parrainer et de commander des œuvres à des artistes individuels qui travaillent dans le domaine public/urbain. Néanmoins, peu de projets d’artistes individuels sont effectivement mis en œuvre. Contrairement à l’Europe, les États-Unis n’ont pas une longue histoire de soutien municipal à des expositions dans l’espace urbain, et par conséquent rares sont les financements et l’engagement du monde artistique local qui permettraient de soutenir de telles tentatives. Il y a eu, bien sûr, quelques exceptions. Par exemple : la célèbre Culture in Action/Sculpture Chicago (1993) de Mary Jane Jacob, les Architectures of Display, œuvre à plus petite échelle, et moins célèbre, réalisée à New York en 1995 (avec la collaboration d’artistes et d’architectes dans des projets de magasins et d’autres entreprises dans le district de Soho à Manhattan), et enfin in SITE97, un ensemble de projets liés au contexte, et réalisés par des artistes qui travaillaient sur la zone frontière entre San Diego et Tijuana. Mais il n’existe pas aux Etats-Unis de tradition conjuguant l’art d’avant-garde in situ et la problématique de l’espace civique/public. On pourrait argumenter, de manière convaincante selon moi, que l’utilisation de l’espace urbain en tant que milieu servant au développement d’expositions d’art a aussi fondamentalement cherché à élargir et à repenser les relations entre la production artistique et l’ensemble du domaine socioculturel. C’est là une re-production symbolique (et dans une certaine mesure, matérielle) de l’espace urbain au service d’activités culturelles spécialisées, activités qui n’entrent pas facilement dans des catégories comme la publicité, le commerce, les affaires, la culture populaire, le tourisme et les applications connexes. Mais en même temps nous comprenons bien que l’utilisation de l’espace urbain comme cadre d’une exposition de groupe soit liée à la mise en place de nouvelles possibilités d’interrelations entre production d’art in situ, et “tourisme culturel”.
Parmi les exemples importants, on peut citer la dernière Biennale d’Istanbul (où l’exposition était dispersée dans divers centres de la ville), ainsi que le Skulptur.Projekte en cours à Münster, qui a toujours utilisé la ville comme une toile de fond neutre.
Fondamentalement, l’exposition dans l’espace urbain devrait s’efforcer de réinventer les relations entre production et réception, entre art et public, entre consommateur et producteur. De plus, le développement d’expositions en interdépendance avec les espaces architecturaux et les infrastructures de la ville exprime le désir d’inventer un nouveau modèle d’exposition. Cela devrait motiver à son tour de nouvelles possibilités de pratiques artistiques.
Autrement dit, une structure de commissariat orientée vers la ville pousse les artistes à repenser les conventions de leurs pratiques respectives en rapport avec les multiples trajectoires matérielles et imaginaires de la ville. Mais un certain nombre de questions persiste : est-ce que l’on réinvente vraiment quelque chose dans ces conditions ?
Ou encore : est-ce qu’une exposition relative à la ville se limite-t-elle à fournir à l’artiste un lieu institutionnel élargi, c’est-à-dire, le déploiement et/ou la fragmentation du site muséal en une série d’espaces urbains distincts ? Si l’environnement urbain devenait la scène la plus étendue et la plus globale de la pratique artistique, cela transformerait-il fondamentalement la relation entre l’artiste, l’œuvre d’art et le public ? Qui va répondre à ces questions ? Si l’on en vient à produire des expositions pour des espaces urbains, il faudrait débattre publiquement de ces questions et donner la parole à tous ceux qui habitent ce milieu urbain particulier : non seulement les spécialistes de l’art, mais aussi les représentants de tous les milieux économiques, professions, appartenances culturelles et ethniques, à tous les goûts, désirs et tendances idéologiques. Un discours public ouvert et inclusif sur la fonction et le sens des expositions dans l’espace urbain devrait, espérons-le, encourager l’apparition de nouvelles lignes de communication et faire tomber les frontières symboliques et effectives entre les disciplines spécialisées.
Par-delà le territoire concret de la ville proprement dite, l’Internet et la toile servent à exploiter de nouveaux types de milieux urbains et méta-urbains virtuels, une exploration rendue plus facile grâce aux modes interactifs de communication. Les relations réciproques entre le monde autonome de la ville et le monde en ligne de la toile sont devenues un domaine d’exploration capital. Il nous oblige à repenser les modes traditionnels par lesquels nous organisons nos positions et nos identités face au corps, à la communauté, à la ville, à la nation, au temps et à l’espace, et au monde. Nous vivons dans un monde post-euclidien où les types anciens de cartographie ont cessé d’être entièrement fiables, où les distinctions – à la fois au niveau de la théorie et de l’expérience vécue – entre le monde autonome matériel et le monde en ligne immatériel, sont de plus en plus difficiles à cerner. Chaque fois que nous pénétrons dans l’Internet, et que nous construisons des choses sur la toile, nous nous trouvons immédiatement dans une dimension spatio-temporelle rationnelle (sur le terminal d’ordinateur), mais en même temps nous sommes jetés sur une scène éphémère de flux continus qui résistent à toute explication classique. Si je vis dans la ville et suis branché sur Internet, je suis localisé et disloqué, branché sur l’extérieur, quelque part et nulle part, tout cela au même moment. Bien sûr, il y a là encore un paradoxe. Je suis dans un état constant d’ “entre-deux” lieux. À un niveau cognitif, je circule entre tous les centres urbains, les extensions suburbaines, les bourgades rurales, et divers autres territoires intermédiaires, transnationaux, globaux.
En un certain sens, l’espace effectif de la ville est dispersé dans le terrain virtuel de la toile, et vice versa. On peut théoriser la toile comme un mélange composite de villes théoriques multiples, organisé selon la nouvelle dynamique où s’entrecroisent la communauté et la communication. Avec la venue de la nouvelle technologie de “toile sans fil”, le téléphone mobile devient l’appareil de l’Internet portable qui permet tous les modes d’interface en ligne. Tout est mis en connexion avec tout le reste. Ainsi la question n’est plus de savoir où vous êtes physiquement situé, mais si (et comment) vous êtes connecté. En invoquant le travail visionnaire du groupe britannique Archigram, on pourrait dire que les centres urbains sont aussi devenus des constellations d’interfaces sans fil pilotées par des gens. Peut-être que les villes elles-mêmes (et leurs alentours suburbains) sont toujours le lieu du commerce, de la culture et de l’information, mais la toile est devenue le lien flottant entre tout ce qu’il y a de villes, bourgades, entreprises, institutions et individus virtuels. Autrement dit, les villes sont maintenant “branchées sur l’extérieur”, ce qui facilite de nouveaux échanges (aux niveaux symbolique et littéral) entre les territoires suburbains et ruraux. Il n’est pas seulement question de ce qui se déploie dans l’espace effectif d’une ville donnée, mais, chose plus significative, de la manière dont ce milieu local interagit avec d’autres milieux locaux de par le monde, à travers l’Internet et la toile.
“L’espace public urbain n’est pas simplement non-privé – ce qui reste quand tout le monde a protégé son domaine privé derrière un mur. Un espace n’est véritablement public, comme Kevin Lynch l’a fait remarquer, que dans la mesure où il est vraiment, ouvertement, accessible et accueillant pour les membres de la communauté qu’il dessert. Il doit aussi accorder à ses utilisateurs une très large liberté de réunion et d’action. Et il doit y avoir, sous une forme ou l’autre, un contrôle exercé par le public sur son utilisation et sa transformation dans le temps. Il en va de même pour le cyberespace public, de telle sorte que les créateurs et les conservateurs des secteurs publics, semi-publics et pseudo-publics du monde en ligne – tels ceux qui construisent les places urbaines, les parcs publics, les halls d’entrée des immeubles de bureaux, les atriums des centres commerciaux, et les rues principales de Disneyland – doivent prendre en compte ceux qui sont admis et ceux qui sont exclus, ce qui peut et ce qui ne peut pas s’y faire, qui fait régner ses normes, et qui exerce l’autorité.”2
En effet : comment l’autorité s’exerce-t-elle sur les espaces urbains, réels et virtuels ?
Qui décide de l’inclusion et de l’exclusion ? Aujourd’hui, nous nous construisons en relation à l’espace tangible mais également au cyberespace, et pour mettre en place des expositions d’art dans l’espace urbain, il s’impose de toujours prendre en compte cette évolution.
1 Kevin Lynch, The Image of the City, MIT Press, Cambridge, Londres, 1960.
2 William J. Mitchell, City of Bits, MIT Press, Cambridge, Londres, 1996.